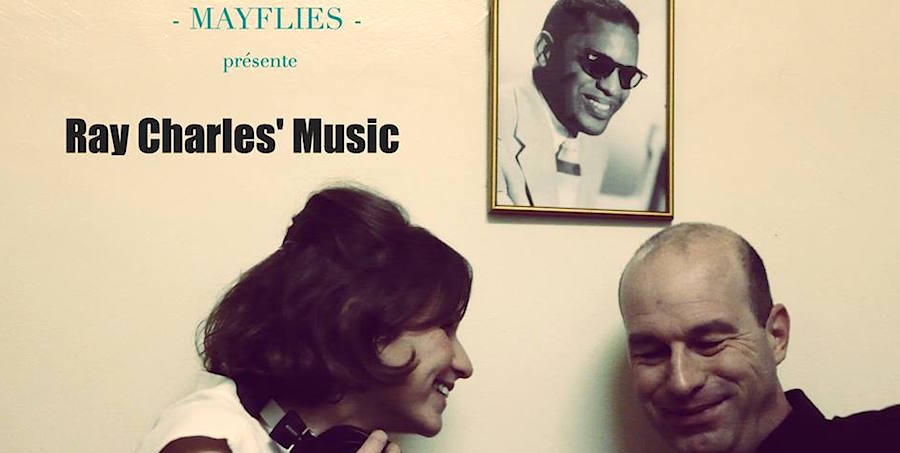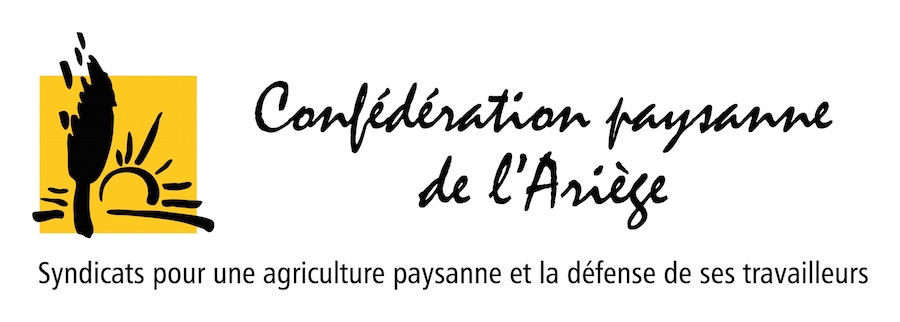Du 31 mars au 2 avril 2017, la 11e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art invite passionnés, amateurs, curieux et familles à (re)découvrir le savoir-faire exceptionnel des professionnels des métiers d’art.
Thème 2017 : « Savoir(-)Faire du Lien »
Les Journées Européennes des Métiers d’Art 2017, orchestrées au niveau national par l’Institut National des Métiers d’Art, rassembleront les métiers d’art et le public autour du thème : « Savoir-Faire du Lien ». L’occasion pour les participants de valoriser la force des liens que les métiers d’art tissent et nourrissent au quotidien : liens entre les générations, entre les métiers, entre les acteurs économiques, entre les territoires, entre les traditions et les cultures …
L’association «Made in Ariège» lance, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, « La Signature des Métiers d’Art en la cité comtale de Foix ».
Sous la Halle aux grains – samedi 1er et dimanche 2 avril – de 10h à 19h
– Exposition vente et démonstration des savoir-faire d’Artisans d’Art :
– Expositions-Ventes des Artisans par secteurs d’activité : Décoration, Ameublement, Textile, Céramique, Bijoux et démonstration de savoir-faire. Gourmandises pour le plaisir des yeux et des papilles avec 3 Artisans de bouche : Le Dur à cuire (gâteaux préparés et cuits sur place à la broche), Sarrazine (Crêpes. Caramel beurre salé), Rose et Chocolat (Chocolat cru avec démonstration de sculpture).
Les exposants :
- Aymard Daniel : Atelier de St Cyrac
- Baque Rose : Celloula
- Berto Liliane : Bijoux et accessoires
- Boyer Dominique : Rose et Cacao
- Bruyère Laurence : Gravure tous supports
- Cabrita Virginie : Savonnerie Loumartin
- Chevineau Romain : Le Dur à Cuire
- Delvitto Eliane : Créati’feutre
- Dumoulin Suzanne : Suze Céramique
- Dupont Romy : Za’Swing
- Fischer Heiko : Las Casas
- Fourest Viridiana : Sarazine
- Friley Julie : Sculptuoplantes
- Gil Christine : Couette Maxime
- Guédon Céline : Atelier en Transhumance
- Laffont Philippe : Tapissier Décorateur
- Manaut Pérrine : Poda Céramique
- Martin Eric : Eto
- Morère Jacques : Ebeniste
- Noël Annie : Aux doigts de Fée
- Rimbault Christophe : Vitraux de Lux
- Robin Catherine : Atelier de reliure
- Seguelas Julie : JSP Créatrice
- Seltan Mireille : Mireio Design
- Turke Catherine : La Riveloise
- Virginio David : Mysticuir
Dans le Petit Jardin, la Passéjade – samedi 1er et dimanche 2 avril – de 10h à 19h
– Découverte d’Univers Artistiques : Sculpteurs, Tresseurs, Soudeurs, Graveur …
– Réalisation d’une œuvre collective, un défi artistique avec la participation des artisans – Quand les matières se rencontrent … Verre, Terre, Feutre, Osier
– Atelier participatif dans le petit jardin – samedi et dimanche 2 avril – de 10h à 12h et de 14h à 16h
Sur réservation (06 89 66 26 39) sur le feutre avec Céline et du Street’Art (le dimanche uniquement) avec Odul « collectif FAUT QU’CA POUSSE ! »,
Dans les rues de Foix – samedi 1er et dimanche 2 avril
– Parcours des Arts : découverte d’artistes dans les vitrines du centre historique (rue Bayle, rue Lafaurie, rue des Marchands et rue Labistour).
– Déambulation de rue sur le thème d’Alice au Pays des Merveilles proposée par la « Limonaderie », pôle artistique (samedi après-midi)
Et aussi…
– Inauguration officielle de la Limonaderie vendredi 31 mars à 19h avec l’association Made in Ariège et les Métiers d’Art.
– L’apéro des Artistes à partir de 19h30 le samedi 1er avril à la Limonaderie
– La boutique associative Made in Ariège sera ouverte toute la journée le samedi 1er et le dimanche 2 avril.
Les Métiers d’Art à Foix
La Signature des Métiers d’Art se déclinera tout au long de l’année autour de 3 axes
1/Les JEMA 2017
Animation au centre-ville les 1er et 2 avril, avec une trentaine de professionnels, des expositions et des démonstrations.
2/ Un circuit artisanal au cœur de la ville
L’association Made In Ariège, représentant une cinquantaine d’artisans, trouvera parmi ses membres une demi-douzaine de professionnels intéressés par une présence physique au centre-ville de Foix. Elle assurera ensuite le suivi et l’animation de ce réseau : calendrier d’animations, démonstrations, accueil du public.
3/ Espace d’animation collectif pour les artisans d’art
Made In Ariège animera au centre-ville un local d’exposition des créations de ses adhérents. Un local suffisamment grand devra également permettre d’accueillir des stages « découverte » à destination des fuxéens et être un lieu de co-working pour des artisans souhaitant travailler ensemble.