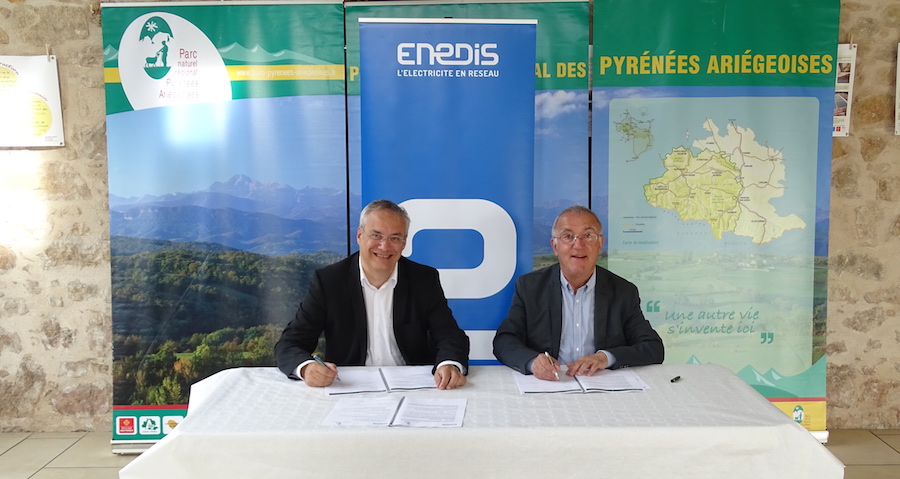Il y a quelques semaines, sur notre page FaceBook, nous avons été interpelés par un de nos « fans » qui nous donnait connaissance d’un article du journal écologique Reporterre intitulé : «La FNSEA veut faire disparaître les petits cours d’eau de nos cartes» (voir l’article) et nous indique que de nombreux cours d’eau ariégeois sont menacés. Lisant l’article, nous prenons connaissance de l’association «Le Chabot» avec qui nous prenons contact. Quelques jours plus tard nous rencontrons son porte-parole, Monsieur Henri Delrieu et son Président Monsieur Bernard Danjoie, au bord du ruisseau des Trois Bornes sur la commune de Montaut et ils nous expliquent le combat de l’association.
L’association le chabot est agréée association de protection de l’environnement, elle est est membre de France-Nature-Environnement (FNE). Elle est très attachée au principe de l’action en partenariat avec les autres associations intéressées au milieu naturel rivière : Comité Ecologique Ariégeois, Pêcheurs, associations de protection d’autres cours d’eau.
Tout commence avec la Lema
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (Lema) du 30 décembre 2006, transpose dans le droit français une directive européenne sur l’eau adoptée en octobre 2000. Cette loi a pour objectif — entre autres — de parvenir à un « bon état » écologique des masses d’eau douce d’Europe d’ici 2015 ( on devait atteindre 70% de bon état écologique des masses d’eau douce en 2015, en 2017 nous en sommes à 30%).
La FNSEA, qui sait à quoi s’en tenir, y voit une menace directe : l’agriculture industrielle dissémine massivement des pesticides et pollue les rivières et les rivages avec ses nitrates. En 2014, l’Europe a d’ailleurs condamné une nouvelle fois la France pour sa politique trop laxiste contre l’épandage des nitrates. (Art. Repoterre)
Le combat de l’association Le Chabot
«Le 1er ministre, Manuel Valls, devant le congrès de la FNSEA, a été très clair» Explique Henri Delrieu «moins de contrôles, des contrôles plus ciblés, donc à terme moins de fonctionnaires sur ces dossiers, moins de loi sur l’eau… et donc moins de protection de nos cours d’eau. »
«Le ministère a donc confié une mission à notre députée Frédérique Massat qui a travaillé 25 points pour alléger la pression de la loi sur l’eau sur la profession agricole notamment. Dans cette proposition d’allègement figure la révision de la géographie hydrographique de la France, sans géographes, sans hydrologues, sans scientifiques, sans tenir compte des multiples jurisprudences, mais sous la pression du lobby agricole et pour satisfaire des intérêts particuliers et économique. Tout le travail qui a été effectué par des cartographes pendant plus de deux siècles est aujourd’hui remis en cause.»
«L’enjeu aujourd’hui, est de redéfinir et cartographier ce qui sera désormais considéré comme un cours d’eau et donc « soumis à la loi sur l’eau » et aux contrôles y afférents – ou pas.
Le réseau chevelu, constitutif de nos cours d’eau, mais souvent non cartographié et ne portant pas forcément de nom propre, est dans le collimateur et risque fort d’en prendre un vilain coup.»
«Notre travail récent en partenariat avec le CIAPP (Conseil International pour la Protection des Pyrénées) nous a permis de voir rapidement les risques à partir de l’exemple d’un chevelu que nous venions d’étudier : le Crieu. Des sources vont « disparaître », des tronçons ne seront plus pris en compte, des zones humides ne seront plus protégées, des affluents seront effacés.
Tout au long de la concertation nous avons réaffirmé nos positions à savoir qu’un un cours d’eau est qualifié par :
- la présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine, y compris un cours d’eau naturel à l’origine rendu artificiel par la suite,
- la permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année, apprécié au cas par cas en fonction des données climatiques et hydrologiques locales.
Cette appréciation du débit rend caduque toute définition qui exigerait plus de six mois de débit par an. Elle permet de reconnaître les cours d’eau à régime atypiques, temporaires et non permanents.
Au regard des objectifs fixés par la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) d’atteinte du bon état écologique de l’eau, consciente du risque évident d’oublis sur une carte établie dans la précipitation et sous la pression de syndicats professionnels ayant clairement annoncés leur désir d’une cartographie réduite, notre association retient pour seuls critères, ceux reconnus et validés par les juridictions.
Ainsi nous demandons à ce que soit retenu comme cours d’eau :
- l’intégralité du linéaire du chevelu, constitutif à part entière de notre réseau hydrographique, tel que présent sur les cartes IGN au 1/25000 ième
- à partir des documents issus de BD Topo (Base de données topographiques) et BD Carthage (Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l’eau et du ministère chargé de l’environnement), tous les cours d’eau recensés en bleu foncé ou clair, continu ou intermittents, nommés ou non, ainsi que tous ceux en rose (à quelques rares exceptions confirmées contradictoirement sur le terrain)
- les affluents ou portions de cours d’eau, oubliés de la cartographie issus de BDC ou BD Topo, que nous ajoutons en rouge sur les extraits de carte ci-joints. Ces ajouts, très partiels et incomplets, ne limitant pas la base définitive des observations que nous pourrions relever ultérieurement.
Ainsi, c’est cours d’eau par cours d’eau que se fait actuellement l’analyse. Vous comprendrez que les professionnels, agricoles, forestiers, industriels… qui ont des intérêts économiques forts à voir des cours d’eau disparaître et avec, leur protection, sont à l’œuvre et déjà bien organisés.
Si nous restons l’arme au pied, ce sont des centaines de milliers de cours d’eau en France qui vont perdre leur statut de masse d’eau.
Si nous n’intervenons pas, le rapport Massat aura donc abouti à une opération de « grand nettoyage par le vide » de la loi sur l’eau.
Notre association s’est engagée très tôt sur ce difficile dossier. Nous avons à ce jour établis près de 100 fiches de reconnaissance cours d’eau. C’est considérable et notre action s’est fait connaitre au niveau national»
Henri Delrieu – Porte parole de l’association « Le Chabot »
Quelques exemples : Cartographie des cours exemple
Les articles de Reporterre:
reporterre.net/Quand-le-gouvernement-et-la-FNSEA-redessinent-la-carte-des-cours-d-eau
reporterre.net/La-FNSEA-veut-faire-disparaitre-les-petits-cours-d-eau-de-nos-cartes