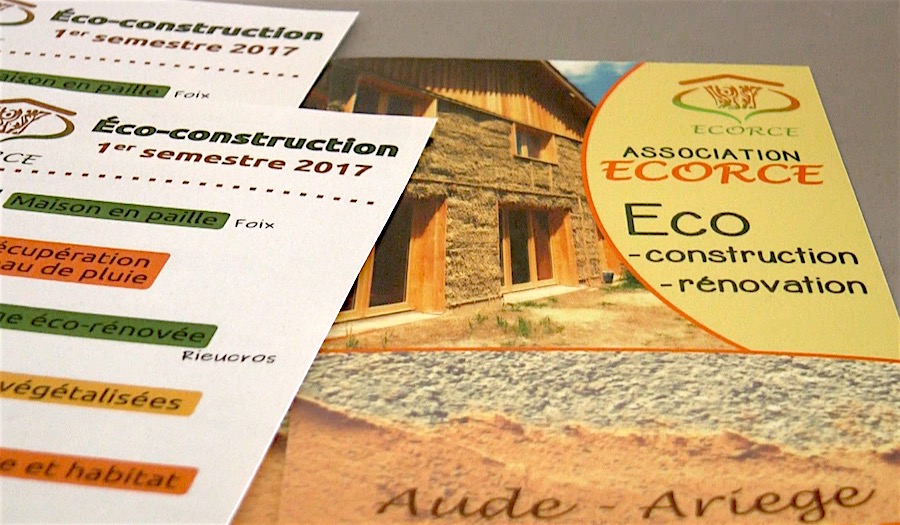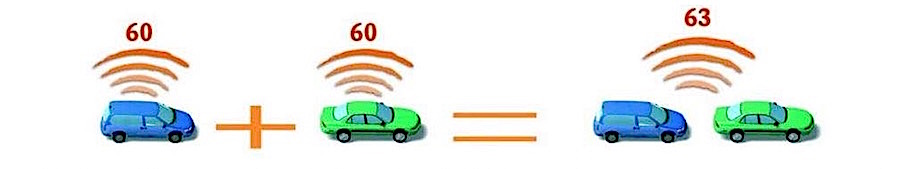Dans le cadre des élections législatives à venir, notre association « le Chabot » de protection des rivières s’adresse aux candidats en Ariège.
Association « Le Chabot » de Protection des Rivières Ariégeoises : pour une autre politique de l’eau
Madame, Monsieur,
Vous avez souhaité être candidat-e aux élections législatives et vous aurez donc, dans votre possible mandat, à prendre en compte les problèmes environnementaux, aujourd’hui au cœur des préoccupations de nombre de vos concitoyens, que vous souhaitez représenter.
En tant qu’Association de Protection de l’environnement, spécialement des systèmes fluviaux et des milieux aquatiques, nous estimons essentiel de faire le point de ces questions avec vous.
L’association « Le Chabot » de protection des rivières ariégeoises a en effet suivi avec un grand intérêt les positions des grandes tendances politiques qui se sont exprimées sur les problématiques de l’eau et de la protection des milieux aquatiques. Notre constat est que la vision simpliste à court terme de l’eau, strictement comptable et consumériste, domine toujours les débats. Les enjeux écologiques sont peu pensés et peu ou pas du tout assumés.
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE), révèle que seulement 45% des masses d’eau de surface sont en bon état écologique en France et que, pour l’état chimique, exprimant la présence de substances comprenant les métaux lourds, les pesticides, les nitrates, etc., 55% des masses d’eau affichent un mauvais état. Ces résultats sont lourds de menaces pour l’avenir.
L’Ariège, « tête de bassin versant » que l’on pourrait croire protégée, n’échappe pas à ce constat désolant. Près de la moitié de ses masses d’eau n’a pas atteint le « bon état des eaux » en 2015.
Il faut réagir localement comme nationalement à cet état des lieux. Il est indispensable et urgent d’impulser une autre politique publique de l’eau où le respect des milieux est le passage obligé.
Aussi nous souhaitons connaître votre position sur les points que nous développons ci-après.
L’eau, bien commun de première nécessité, doit être gérée dans le cadre du service public. Notre association réaffirme la nécessité de création d’un grand pôle public national de l’eau, décliné localement, associant à sa gestion, Etat, collectivités, usagers, professionnels et associations de protection des milieux.
Annuler la démarche de « Cartographie des cours d’eau » actuelle qui vise à la disparition administrative pure et simple d’une grande partie des linéaires de notre réseau hydrographique. C’est toute leur protection qui disparaît avec, et c’est l’objectif d’atteinte du bon état écologique de nos cours d’eau qui est totalement remis en question.
Ne bénéficieront plus des protections de la loi sur l’eau tous les cours d’eau qui en auront perdu le statut.
Cette démarche, menée sous la responsabilité des services de l’Etat, fait suite à la demande des deux syndicats agricoles majoritaires, FNSEA et JA dans le seul but de se dégager de la pression des contrôles exercés dans le cadre de la protection des milieux aquatiques. Le gouvernement Valls, après la mission portée par la députée Massat, s’est empressé d’y donner une suite favorable.
L’intérêt général qu’est le bon état écologique est sacrifié là aux exigences d’une agriculture visiblement mal orientée. Il faut parvenir à la compatibilité entre les pratiques agricoles et le bon état des milieux.
« Pour une participation le plus en amont possible des projets » : Conscients de ce que certains projets se heurtent à une méconnaissance des enjeux environnementaux, nous sommes partisans de la mise en place d’un service de médiation environnementale en Ariège. Il nous semble que ce processus, qui ne peut se construire qu’en respectant l’intérêt général de l’environnement et de la santé publique, pourrait permettre de responsabiliser les acteurs qui en acceptent le principe et les résultats.
Il nécessiterait l’intervention de médiateurs neutres et impartiaux permettant un dialogue entre les parties prenantes afin de permettre l’évolution de la conception ou de l’implantation d’un projet par l’ensemble des acteurs et ainsi de renforcer la cohérence sociale en amont.
Sur la gestion quantitative :
Stopper la relance irraisonnée de la micro hydraulique très peu productive etdestructrice des milieux.
Berceau de la « houille blanche », notre département connaît depuis de longues années les « bienfaits » mais aussi les nuisances et impacts du stockage massif d’eau en montagne ou dans le piémont, de la multiplicité des ouvrages de dérivation de l’eau et de son utilisation toujours croissante aux fins de puissances d’énergie hydroélectrique, de soutien d’étiage, d’irrigation.
Le suréquipement des cours d’eau en centrales et « microcentrales » et le stockage massif des eaux par les barrages perturbent fortement l’hydrologie de nos cours d’eau, altèrent durablement leur fonctionnement naturel.
Ils impactent directement par :
– l’ennoiement et la perte définitive de vastes « zones humides », réservoirs uniques d’une riche biodiversité, laquelle représente un des enjeux majeurs du XXIème siècle,
– le réchauffement des eaux superficielles, problématique pour la faune et la flore endémiques et l’auto épuration des eaux.
– de très longs parcours en « débit réservé » signifiant réduction, appauvrissement et mauvais fonctionnement du lit mouillé, avec des conséquences multiples sur la recharge des nappes, la capacité à absorber les crues violentes, l’auto épuration.
– des variations brutales et fortes des débits (éclusées), avec de nombreux dégâts sur la faune, ses sources d’alimentation et ses habitats.
– l’augmentation importante du nombre de jours où les tronçons court-circuités sont réduits au débit réservé par l’augmentation de puissance des installations, lequel débit réservé est toujours inférieur au « débit de crise » (!).
– l’accumulation des ruptures de continuité sur un même cours d’eau,
– l’inversion des débits naturels et leur fort écrêtement qui prive les rivières des débits efficaces à l’entretien de leur lit, tant sur le plan des habitats que de sescapacités fonctionnelles.
On le voit, de nombreux services sont rendus par un bon fonctionnement et une richesse de vie des écosystèmes fluviaux :
– entretien de la capacité du lit à absorber les très grandes crues (puissance de remaniement du lit, dissipation de l’énergie),
– maintien de la capacité du cours d’eau à alimenter les nappes (niveaux atteints et leur fréquence),
– maintien des capacités d’auto épuration (sols et substrats non bloqués, vivants),
– entretien des capacités d’accueil biologique aquatique, semi et péri aquatique (biodiversité, biomasse),
– pérennité des ouvrages, ponts, routes. (dissipation de l’énergie, maintien du profil),
– bien être collectif (cadre de vie, usages non marchands)
– participation à une activité économique diversifiée et à l’attractivité des territoires (tourisme, secteur des activités plein air…)
Nous savons bien que des parties financièrement intéressées, acteurs industriels et agro industriels, refusent d’admettre ces faits. Leur intérêt est d’entraver la définition et la mise en œuvre de politiques publiques écologiques. Mais c’est bien pour conserver ces bénéfices et éviter les coûts démesurés de leur perte que la Directive Européenne Cadre sur l’Eau a vu le jour.
Stopper les politiques de stockages massifs d’eau et initier d’autres pratiques de productions agricoles et de consommation plus économes, respectueuses de l’environnement.
Notre département contribue fortement à l’effort régional et national. Il est le premier contributeur au soutien d’étiage interrégional Adour Garonne, le troisième département national en équipement hydroélectrique. Il stocke l’équivalent de « 3 Charlas » dans ses montagnes et son piémont.
Sous peine de ne pas atteindre ses objectifs du « bon état écologique des eaux » et pour assurer une gestion équilibrée de la ressource, il est temps de réorienter les politiques de gestion quantitative de la ressource vers une gestion moins gourmande, plus économe et de moindres stockages d’eau.
Dans notre département, au motif de difficultés récurrentes de remplissage du barrage de Montbel, qui pourtant bénéficie de dérogations successives au régime des débits réservés, l’IIABM envisage aujourd’hui de prélever, en plus, par captage sur le Touyre, entre 9 et 14 Mm3 annuels dans le but d’augmenter la capacité de stockage et d’« assurer la sécurité » du remplissage de l’ouvrage. C’est la fuite en avant vers plus de stockage, plus de surfaces irriguées, pour toujours plus de monoculture intensive, gourmande en eau et en intrants, fortement perturbatrice d’un bon état écologique des eaux et des milieux associés.
De plus, le Touyre se verrait amputé définitivement d’une eau qui lui fait déjà cruellement défaut, alors même que le projet de sa réalimentation au Col d’en four n’est pas prêt d’aboutir. La qualité des eaux du Touyre, même si elle s’est améliorée ces dernières années, reste dangereusement exposée à la remise en circulation de toxiques stockés dans les substrats et pourrait, de ce fait, contaminer durablement les fonds du barrage de Montbel.
De même la recherche de nouveaux lieux de stockages supplémentaires sur le linéaire du l’Ariège, qui cumule déjà sur son bassin versant 250 Millions de m3 de stockages et plus de 65 Millions en piémont, ne pourrait qu’artificialiser encore d’avantage ses débits et décupler ses dysfonctionnements morpho dynamiques.
L’association « Le Chabot » désapprouve totalement cette politique de stockage intensif, de suréquipement des cours d’eau et la vision consumériste de l’eau qu’elle porte. Cette vision purement marchande, au profit quasi exclusif de quelques lobbies hydrauliciens ou agro-industriels ne peut qu’exacerber les conflits d’usages et impacter durablement des milieux aquatiques déjà bien malmenés.
Dans l’intérêt général, il est grand temps d’assumer une réflexion globale sur la reconquête de milieux aquatiques de qualité qui, sans exclure l’optimisation des ouvrages fonctionnant actuellement, passe par un moratoire sur toute politique de nouveaux stockages ou d’équipement supplémentaire sur nos cours d’eau.
Sur la gestion qualitative :
Les cours d’eau Ariégeois, situés en tête du bassin versant Adour Garonne, constituent un élément essentiel dans la chaîne des solidarités de bassin. Il est urgent de s’attacher à promouvoir la restitution aux milieux naturels d’eaux de qualité.
Compléter et mettre à jour les équipements d’assainissement collectif :
Considérer que l’essentiel des équipements d’assainissement est à jour comme il est fait, revient à repousser à toujours plus tard la réfection des stations vétustes, égrenées tout au long du linéaire de nos cours d’eau. Ainsi, sur le seul linéaire de l’Ariège un grand nombre de stations sont à rénover ou à reconstruire.
Les pollutions et agressions aux milieux aquatiques, qui sont les réceptacles finaux des effluents domestiques, participent aussi à leur eutrophisation. L’explosion d’algues aquatiques sur le lac de Labarre, la prolifération récente de plantes aquatiques dans le lit de l’Ariège en sont une des conséquences visibles et spectaculaires.
Depuis la disparition des SATESE départementaux, aucune information sur la qualité des effluents traités et rejetés dans le milieu naturel n’est mise à disposition du public. C’est regrettable et cela jette un doute légitime sur les performances de nos stations d’épuration.
L’association renouvelle sa démarche qui préconise d’associer, avant tout rejet dans le milieu naturel, une zone tampon sur tertre, puits filtrant ou lagunage végétalisé.
Faciliter des solutions alternatives d’assainissement en zone rurale :
Un grand nombre de cœurs de villages et de hameaux ruraux sont toujours sans solution d’assainissement. Des techniques d’assainissement par phyto-épuration, plus simples de mise en œuvre et moins onéreuses, peuvent y être mieux adaptées.
L’assainissement individuel, traitant différemment les eaux vannes des eaux grises, est à encourager. Associé à des méthodes de traitement par phyto-épuration, il peut participer efficacement à la résorption des micro pollutions.
Intégrer les solutions écologiques aux équipements des lieux touristiques :
Pour les milieux eau, l’Ariège , département à ambitions touristiques, ne peut rester à la traîne et continuer à refuser d’installer des toilettes sèches dans les sites naturels fréquentés : aires de stationnement au départ des randonnées, aires d’accueil des châteaux cathares, refuges de haute montagne (où les capacités d’auto épuration des milieux sont faibles)… Nos voisins très touristiques Aude et Pyrénées Orientales ont depuis longtemps abandonné les préjugés et ont équipé de nombreux sites sur leur territoire.
Favoriser une agriculture respectueuse de l’environnement, protéger et réhabiliter les nappes alluviales et pluviales de plaine :
Les données récentes de l’IFEN font ressortir une contamination généralisée des eaux de surface et des eaux souterraines par les pesticides et herbicides. Les zones de grande agriculture intensive concentrent les taux de nitrates les plus forts. Ainsi, depuis des années, la grande nappe alluviale de la plaine de l’Ariège est rendue impropre à la consommation humaine. Ses taux de concentration de nitrates (0,9 à 1 g/l) sont deux fois plus élevés que les normes admises. Les plans d’actions concertés spécifiques se succèdent, sur fonds publics, mais rien pour l’instant n’indique des changements notables. Une politique, volontariste de soutien à d’autres pratiques et d’autres productions agricoles devrait être engagée.
Le raccourci tentant « nous allons vers des changements climatiques, il y aura des sècheresses donc nous allons faire de grands stockages » est une démarche de fuite en avant, qui refuse de traiter les problèmes de fond et qui prépare des problèmes d’eau toujours plus graves.
Il est urgent de se donner des objectifs forts de soutien à une agriculture biologique, moins gourmande en eau et en intrants, plus respectueuse de l’environnement. Il est grand temps de soutenir activement une politique agricole respectueuse où la production bio, l’agroforesterie, l’agro écologie et les relocalisations de productions utiles et consommées localement tiennent la place de choix qu’elles méritent et qu’attendent les populations.
En zone de montagne et moyenne montagne aux terrains difficiles, l’évacuation des fumiers, inévitablement stockés souvent trop près des cours d’eau, doit pouvoir être assurée par des dispositifs semblables aux CUMA, de même que leur réemploi.
Protéger les nappes et mettre fin à leur remblaiement par des déchets du BTP ou autres
Enfin, il convient de réorienter complètement les politiques actuelles d’exploitation des graves alluvionnaires. La mise à jour des nappes phréatique, pluviale et d’accompagnement de l’Ariège, de l’Hers ou du Salat sur de très grandes surfaces et profondeurs, met en danger ces masses d’eau.
Il est inadmissible de prendre le risque de polluer ces réserves d’eau, qui réalimentent nos cours d’eau. Elle doivent être conservées et disponibles pour le futur. La pratique d’enfouissement en eau des déchets dits « inertes » doit cesser impérativement.
Varilhes le 9 mai 2017 APRA « Le Chabot »